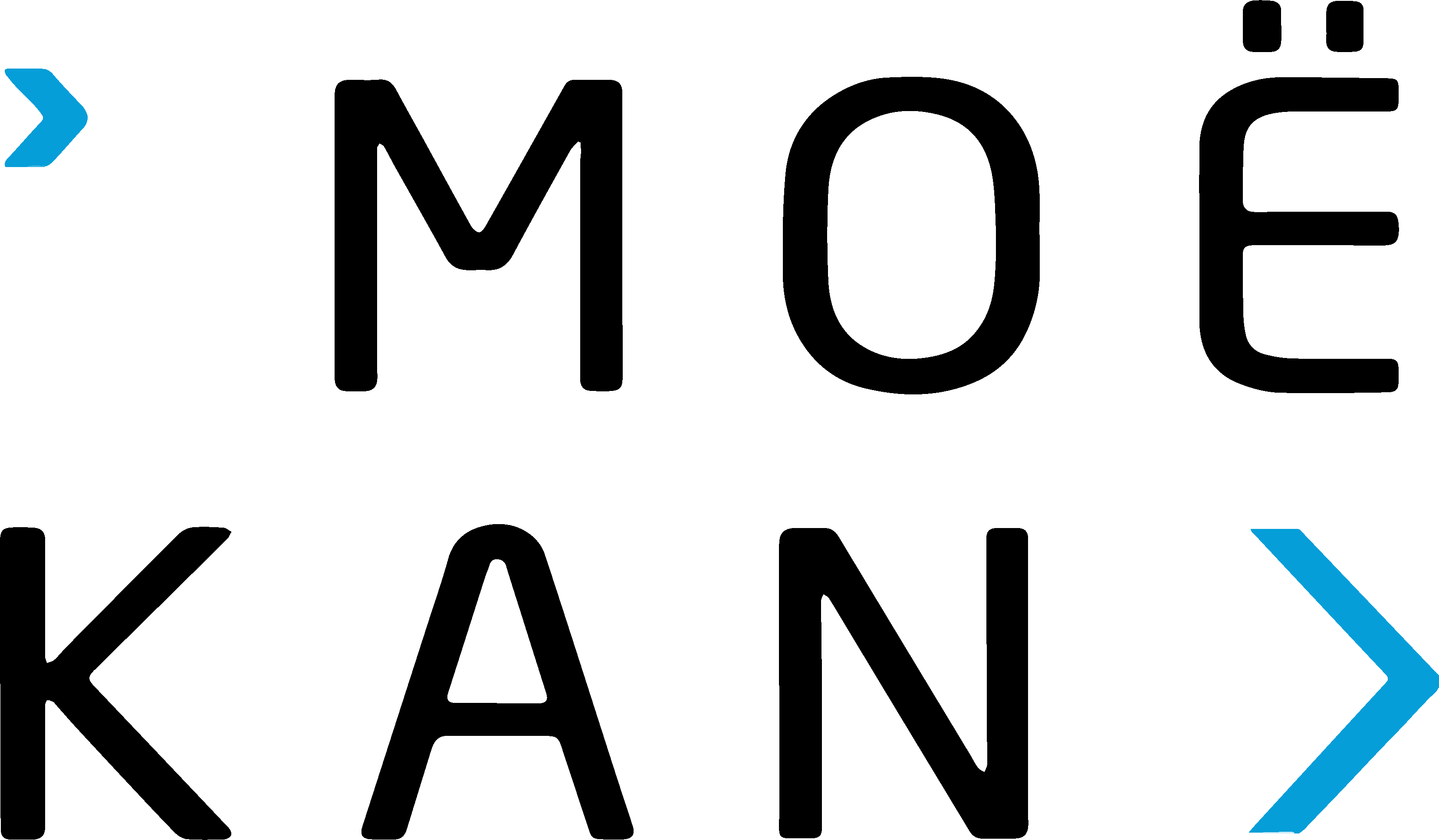Figure du milieu du spectacle en région Bretagne, Claude Guillou intervient sur de nombreux festivals. Qu’il soit régisseur général ou chef électricien, ceux qui le côtoient apprécient sa rigueur, son professionnalisme et sa bienveillance. Les Moe-Kan, qui collaborent avec lui sur le Festival des Rias depuis 2013, ont eu envie de dialoguer avec lui autour de son parcours passionnant et de sa vision de ses missions.
Figure du milieu du spectacle en région Bretagne, Claude Guillou intervient sur de nombreux festivals. Qu’il soit régisseur général ou chef électricien, ceux qui le côtoient apprécient sa rigueur, son professionnalisme et sa bienveillance. Les Moe-Kan, qui collaborent avec lui sur le Festival des Rias depuis 2013, ont eu envie de dialoguer avec lui autour de son parcours passionnant et de sa vision de ses missions.
Moe-Kan : Comment en arrives-tu à exercer la fonction de régisseur général dans le spectacle ?
Claude Guillou : C’est le résultat d’un enchainement de rencontres qui m’amène à travailler dans le spectacle sans en avoir, au départ, le profil. Quelqu’un remarque que je suis un « besogneux », et que j’ai soif d’aventures. Du coup, je colle à mon premier métier dans le spectacle, le montage de structures et de scènes. Je me retrouve alors à partir en tournée dans la France entière et l’Europe, avec, au maximum, six camions.
Pourtant, je ne viens pas de ce monde. J’ai obtenu différents diplômes et qualifications dont un CAP de maçon. Je suis parti quatre ans sur un bateau avec un ami pour vivre de la pêche. La conjoncture est difficile, c’est métier le plus dur que j’ai exercé. Il m’a cependant appris beaucoup de choses, dont l’humilité. Nous ne sommes que des êtres humains face à l’élément qu’est la mer. C’est formateur. Nous déposons le bilan, et je prends alors la route pour trouver d’autres solutions. Je passe l’ensemble des permis poids Lourd (PL, SPL, transport en commun, …). J’ai dû faire plus de deux millions de kilomètres en bahut, tout en changeant d’employeur quasiment tous les trois mois.
J’ai également une formation initiale en électricité. Je mets ces compétences en pratique en intégrant le monde du spectacle, puisque, dans l’entreprise où je travaille à l’époque, nous montons des scènes et l’énergie scénique.
Un métier exigeant
MK : Quelle est la chronologie du parcours que tu viens de nous présenter ?
CG : Je ne suis décidément pas fait pour la situation d’apprentissage scolaire. Je pars alors sur un bac pro en électricité. J’enchaine plusieurs emplois dont de la pause d’antennes en 1987, juste après l’ouragan qu’a subi la Bretagne (220 Kms/h mesuré à Granville). Après cet épisode climatique violent, je me retrouve donc sur tous les toits du Finistère sud. Cela m’a permis de savoir que je n’avais pas le vertige, et donc que j’étais apte au travail en hauteur. Cela me sera utile plus tard dans le montage de scène.
Je rencontre ensuite un gaillard que j’ai envie de suivre. Il devient un peu mon mentor. Début 1991, nous achetons un bateau de pêche, le « roule ta bosse » que nous menons du nord de la Bretagne, de Loguivy de la mer à Loctudy. Nous pêchons au casier, au filet. Nous avons 600 casiers et 14 kilomètres de filets.
MK : Quel est ton statut alors ? Tu as passé des formations pour cela ?
CG : Je suis armateur embarqué, mais je n’ai passé aucune formation, je n’en ai pas eu le temps. J’ai obtenu une dérogation pour cela.
MK : Quelle est la journée type d’un armateur marin embarqué en 1992 ?
CG : L’activité principale du bateau est la pêche à l’araignée. Cela se vend alors 25 francs le kilo (environ 5,5 euros). Avec 500 kilos à la semaine, nous arrivons juste à payer le gasoil du bateau. Au début de cette aventure nous avons également un droit de pêche sur la coquille Saint-Jacques, nous le perdons car il est rattaché au propriétaire du bateau et non au bateau. D’un seul coup, on perd 200,000 francs. C’est une première difficulté. La seconde, c’est que, quatre mois après que nous ayons acheté le bateau, les grandes surfaces attaquent le marché. Le prix de vente chute alors à deux francs. Nous nous disons alors que pour gagner notre vie, nous allons nous-mêmes les revendre à 25 francs en faisant les marchés. En plus de pêcher, nous faisons douze marchés. Au bout d’un moment, nous n’avons presque plus le temps de dormir.
Pour répondre à ta question, donc, pendant presque un an, je dors deux heures par nuit. A l’époque je fais 76 kilos, je ne mange que des araignées et du poisson. Au bout de trois ans d’activités, nous plongeons économiquement. Je perds tout. Lorsque le « roule ta bosse » rentre une dernière fois au port, il est sévèrement endommagé. Je vais voir mon banquier pour emprunter pour les réparations. Ce dernier m’explique que nous ne serons plus financés, nous sommes trop petits. Nous faisons partie du « plan Puech ». C’est le ministre de l’époque qui décide d’armer moins de bateaux, et donc de donner de l’argent pour mettre les autres à la casse et lancer la construction de bateaux plus importants.
De la route à la maçonnerie saine
Je n’ai plus rien. En 1995, je passe mon permis super-lourd. Je fais tout ce que les autres ne veulent pas faire. J’enchaine les heures au-delà des limites légales. Par exemple, nous sommes deux chauffeurs et nous partons à 7 heures du matin d’une ville du sud Finistère avec 27 tonnes de porcs. Arrivé à Rungis, nous déchargeons, nous mangeons un morceau, et nous repartons chargé de messagerie vers Saint-Brieuc. Nous finissons à 5 heures du matin, et nous repartons deux heures plus tard. Pour ma part je suis bloqué dans cette situation car j’ai besoin d’argent.
Là, j’en ai marre, j’ai envie d’apprendre un autre métier. Je me forme donc en maçonnerie à l’AFPAA. J’ai trente ans et j’ai envie de construire mon nid. Je découvre parallèlement l’écologie à travers son application au quotidien. Je conçois la maçonnerie comme le fait d’utiliser ce qu’on trouve sur place pour construire (soit de façon vernaculaire), sans avoir à aller chercher des éléments à des milliers de kilomètres. Je me forme ainsi avec l’envie d’aller vers la maçonnerie saine. Je suis embauché, cela ne me convient pas. J’entends parler du portage salarial. Je décide donc de me lancer dans ce cadre, d’autant que cela me permet d’avoir une garantie décennale sur la mise en œuvre du chanvre, car la société qui me porte a les reins assez solides et des connexions dans les assurances. Le chanvre n’a pas de DTU (document technique unifié) à l’époque[1]. Je me lance donc dans cette activité dans le pays de Quimperlé, Concarneau, jusqu’à Lorient.
Ce métier m’amène à connaitre un gars avec qui j’accroche. Nous partageons la passion des chevaux. Je finis un soir à boire un verre chez lui et là, je rencontre quelqu’un qui est alors régisseur technique et qui va me faire travailler pour sa future entreprise. Il monte une entreprise de structure. On se croise régulièrement. Il me propose d’intégrer sa structure fort de mes permis et de mon expérience en montage d’échafaudage.
Comme je n’arrive pas à me projeter dans mon métier sur le long terme, et que je suis en fait en avance sur la demande de maisons plus écologiques, je me lance et apprends alors le métier de monteur de scène.
Ne jamais lâcher
MK : Quel est ton plus beau souvenir professionnel avant ton entrée dans le monde du spectacle ?
CG : Le plus beau souvenir ? Les histoires dingues que j’ai pu vivre avec d’autres. Par exemple, on est sur la plate (un bateau qui permet d’aller sur les sols marins peu profonds). On voit une sole dans le filet de trémail qu’on y utilise. Cette sole glisse entre les mails du filet alors qu’on le remonte. Mon ami fort de ces 110 Kg se penche pour la rattraper, et passe par-dessus bord. Il part au fond. A deux, on essaye de le remonter. Il remonte le sourire aux lèvres, et la sole dans la main. Il ne serait jamais remonté s’il n’y avait pas eu la sole. Cette richesse de ne jamais lâcher ensemble, c’est incomparable.
En 2000, je bascule donc dans le spectacle. L’entreprise est naissante, ceux qui tiennent la société apprennent à le faire. J’ai des facilités à m’adapter. J’apprends à travailler avec un mélange de bénévoles et de professionnels. J’apprends le travail et deux ans plus tard, je suis responsable de chantier. Au début, on tourne beaucoup avec un groupe et une scène de 20m par 15m modulable. On finit à la scène 2 du Festival des Vieilles charrues en 2003. C’est une période de transition durant laquelle on a encore les anciennes scènes en échafaudage, mais en même temps, on voit apparaitre du « tower », les « Mother Gril », … le métier est alors en train de muter.
Les Scaffolders (monteurs d’échafaudages) migrent vers d’autres métiers, car l’échafaudage est en train de disparaitre des scènes.
MK : Tu évoques le moment où se développent les structures spécifiquement pour les scènes alors qu’auparavant, on utilisait l’échafaudage multidirectionnel du BTP ?
CG : Oui, et la mécanisation permet la mise en place de ces nouvelles technologies. Le levage est un dérivé de ce qu’on trouve déjà dans les salles à l’époque.
Je finis par gérer un format où il y a 25 à 30 monteurs. Les structures sont en « Tower » et en « Mother Gril » sur le plateau et les extensions, mais dès que l’on monte de la vidéo par exemple, on monte encore de l’échafaudage.

Une somme de détails
MK : avec le recul, es-tu en mesure de savoir quelle valeur ajoutée tes expériences précédentes t’ont apporté pour ce métier ?
CG : Le transport m’a aidé dans le sens où, lorsque tu montes et tu démontes des scènes, la partie logistique est monumentale. Tu peux savoir monter une scène, mais si tu ne sais pas la ranger dans un camion, il te faudra deux camions de plus. Il te faut également amener l’embase, pour monter la scène, avant les élévations sur le prochain montage à suivre. Pourtant tu démontes les élévations avant de faire partir l’embase. Il faut donc de l’anticipation dans la logistique, et la logistique transport est exigeante. J’ai appris à appréhender le volume d’un camion, la gestion des heures de conduites, etc.
Le fait d’avoir travaillé à son compte, impose en outre une rigueur dans son travail, et cette rigueur, je l’ai acquise dans toutes mes expériences professionnelles.
Au départ, on travaille 15 à 20 heures par jour pour livrer la scène. Deux ans plus tard, on a gagné 5 à 6 heures. Ces 5 à 6 heures montrent qu’on a acquis de l’efficacité. Par exemple, au départ, on faisait taper l’échafaudage au fur et à mesure qu’on montait. Finalement, on tape le plateau, et, une fois que l’on a tapé le plateau, on peut faire taper tout le monde. Si tu fais comme cela, tu peux tout monter. Si tu tapes au fur et à mesure, tu resserres tellement les mailles que tu ne peux plus monter la dernière pièce. Avant de mettre en œuvre cette technique, on a été obligés de fermer la scène aux chariots. On avait tellement étiré en tapant dessus que deux millimètres multipliés par 60 mètres d’ouverture, tu te retrouves dans une situation où cela ne ferme pas. C’est un détail. Je me suis cependant enrichi de nombreux détails de ma vie d’avant pour mon aventure professionnelle actuelle.
En électricité et énergie, c’est identique. C’est une société qui décide de signer un accord avec un loueur de groupe électrogènes pour lancer sur la route des groupes dits « normal secours ». On se retrouve sur des chantiers de taille raisonnable. Pour des festivals de dix à quinze mille personnes, on arrive avec une technologie qui leur permet d’être secourus On commence à monter en gamme dans ce secteur d’activité ou aujourd’hui on a atteint le « zéro coupure ».
MK : Sur quelle zone géographique ?
CG : La France entière. On part d’un festival de Bretagne, et on finit à Macon avec la Star Academy.
Anticiper en communiquant
MK : Aujourd’hui quelle est ton activité professionnelle ?
CG : J’ai l’impression de mettre en pratique un condensé de tout ce que j’ai appris. Mon rôle est de transcrire sur le terrain, par la communication écrite et orale, ce qui a été préparé en amont, afin de ne pas reproduire les erreurs qui arrivent lorsqu’on n’est pas assez préparé.

J’aide les intervenants (prestataires ou freelances) qui arrivent sur un événement à ne pas être pris au dépourvu face à la demande que nous allons leur faire, dans le temps imparti et toujours restreint qu’on leur donne. C’est l’idée de base de la régie technique. Il s’agit d’anticiper le plus possible ce qui peut arriver, mais surtout le communiquer.
MK : Est-ce que cela entre en résonance avec le fait que tu as été obligé de découvrir beaucoup de choses par toi-même ? tu veux offrir à tes collaborateurs ton expérience et limiter l’inconnu, voire la souffrance… ?
CG : Ce sont effectivement des chemins que j’ai empruntés. Mais aujourd’hui nous ne devrions plus être obligés de travailler autant d’heures, par exemple.
MK : et le fait de soigner ton organisation, tu le mets en action dans quels types de missions ?
CG : Aujourd’hui je me retrouve devant des organisateurs qui vont chercher à installer des festivals, des spectacles de rue, des événements, pour retranscrire ce qui va se passer.
MK : Ok, mais comment se déroule concrètement une année de Claude Guillou ?
CG : Une année de Claude Guillou (!) commence par un festival qui se monte de mi-mars à mi-avril qui est le festival Mythos[2]. J’y suis régisseur de site. J’ai pour mission de faire les devis sur la structure, le chauffage, l’énergie, de produire les plans sur l’énergie, la pose des cuisines… j’installe sur les plans tout ce qui va se passer au parc du Thabor à Rennes. Il y a de la poésie, du chant… Cela dure dix jours. En parallèle, j’ai la préparation du festival des Rias[3] qui a lieu en Août et sur lequel je suis régisseur général. J’attaque ensuite (bien que je commence, en fait, dès octobre) la préparation des Vieilles Charrues[4]. Chef électricien, J’ai pour mission d’installer l’énergie sur tout le site du Festival. Je fais également le chef électro sur le festival Fête du bruit à Landerneau[5]. De Mai à Juillet, je suis sur les Vieilles Charrues, puis toute la prépa bureau jusqu’au départ des camions pour fête du bruit. J’enchaîne avec les Rias fin août. Je pars ensuite sur Nantes sur le Grand Champbardement une dizaine de kilomètre au nord de Nantes[6] pour clôturer la saison d’été. J’ai ensuite une pause, puis j’entame la prépa des Transmusicales[7] de Rennes qui ont lieu en décembre. Sur ce dernier Festival, je suis également chef électro.
MK : Quelle est la consommation électrique d’un festival comme celui des Vieilles Charrues ?
CG : 2,7 Mégawatts.
MK : Et les transmusicales ?
CG : C’est plus difficile à dire, car c’est un parc des expositions. Nous n’avons pas la vision sur la consommation de base. On ne travaille pas du tout pareil.
Agir concrètement pour le développement durable
MK : Tu nous a parlé de ta sensibilité concernant le respect de l’environnement. Comment cela s’exprime aujourd’hui ?
CG : J’essaye déjà, dans ma vie personnelle et au quotidien d’être le moins polluant possible. Au niveau professionnel, je peux évoquer, par exemple, le cas des Vieilles Charrues sur lequel, en 2016, il y avait onze groupes électrogènes en fonctionnement contre vingt-huit à mon arrivée à ce poste. Dans un principe il s’agit de privilégier le branchement principalement au réseau, qui est moins onéreux et moins polluant que les énergies fossiles. On utilise également 95 Kwh produits par des panneaux solaires sur un des bâtiments proches du festival.

J’ai, par ailleurs, une autre activité sur ce festival qui consiste à promouvoir les énergies solaires. Par le biais d’une entreprise, BBS, on essaye de développer un groupe électrogène hybride, qui fonctionne avec 10 m2 de panneaux solaires supplantés, au cas où. Cela me permet de rentrer dans les clous de la règlementation en terme d’ERP, parce que je me retrouve avec une énergie secourue. De plus, c’est de l’énergie propre.
L’eau potable distribuée, à partir de cette tour, aux festivaliers est filtrée, entre autres, par une lampe ultraviolet alimentée par ce dispositif. Nous éclairons aussi la zone à partir de cette tour. C’est une manière de développer les énergies renouvelables. Cette année, j’espère passer à 90 % d’utilisation de l’énergie solaire et 10% de groupe générateurs autonomes.
Par ailleurs, dans ma vie personnelle, je vis dans une maison que nous avons construite, ma compagne Sophie et moi, qui disparaitra à 90% sans qu’il y ait de nuisance pour l’environnement dans laquelle elle se trouve.
Le mouvement perpétuel
MK : Sais-tu pourquoi tu restes dans le milieu du spectacle ?
CG : C’est un milieu qui me convient. Par le passé, j’ai pas mal papillonné sans trouver l’équilibre, tout en rencontrant une certaine routine. Dans le milieu du spectacle, tu as du mal à connaître une routine. Tu as toujours de quoi évoluer. Cela permet d’avancer, de continuer à progresser. On rencontre tout le temps des personnes nouvelles. Je m’enrichie de ce mouvement perpétuel.

MK : et quel est ton rapport aux artistes ?
CG : Lorsque j’intervenais dans la structure, on nous demandait d’être présents mais sans être vus. Nous sommes partie prenante du festival, mais nous n’avons pas vocation à interagir avec les artistes. Du coup, j’en ai pris mon parti, et je me suis éloigné du côté artistique. En arrivant dans le milieu des arts de la rue, je me suis senti plus captivé par l’artistique, mais j’ai toujours gardé ce recul. Nous ne sommes pas là pour « taper la discute » avec les artistes. C’est ma façon de respecter leur l’intimité.
MK : Qu’aurais-tu envie de dire aux nouvelles générations de managers techniques qui ont la possibilité d’avoir des parcours de formation professionnelle spécifiques ?
Confronter savoir et expérience
CG : Pour répondre à ta question, je voudrais évoquer une étape de ma vie que je n’ai pas encore abordée. Entre 2006 et 2009, j’arrête tout. J’enchaine alors une pléiade de formations. Prévention des risques et sécurité pour la Licence d’exploitant, Accroche et levage, les CACES, SIAP 1 et 2… Cela me permet également d’être là aujourd’hui. Si je n’étais pas passé par cette étape, je n’aurais pas été en mesure de gravir certaines marches. Ces formations m’ont ouvert l’esprit et permit d’aborder mon activité de manière plus réfléchie.
En outre, dans le rapport aux décideurs, le fait d’être passé par ces formations crédibilise mon discours sur certains aspects.
Pour répondre à ta question, mon plus gros bagage initial, c’est ma volonté. Mais, si je ne passe pas par cette étape, ma carrière ne peut pas évoluer. Ce savoir et ces formations sont donc importants. Concernant les nouveaux managers techniques, ceux qui arrivent sur le terrain aujourd’hui se sont vu fournir des outils, inculquer un savoir, mais ils arrivent sans l’expérience. Le savoir théorique est beaucoup plus important et ouvert, mais il leur manque l’expérience du terrain. Cela va être intéressant de voir ce qu’ils vont faire de ce savoir en le confrontant à l’expérience. Je reste circonspect sur l’universalité du savoir.
MK : Quel est ton plus beau souvenir dans le monde du spectacle ?
CG : J’en ai plein. C’est surtout ces moments où des gens m’ont fait confiance et m’ont permis d’accéder à des situations où je n’aurai pas pu accéder sans cette confiance. Je ne me suis jamais mis en avant, mais il existe des gens qui ont su détecter chez moi ce potentiel.
MK : Où te vois-tu demain ?
CG : Toujours dans le milieu du spectacle, mais avec le souhait d’être plus serein. En tout cas, j’aimerai continuer à ressentir le plaisir de faire ce que je fais.
[1] https://fr.wikipedia.org/wiki/Document_technique_unifi%C3%A9
[2] http://www.festival-mythos.com/2017/
[3] https://www.lesrias.com/
[4] https://www.vieillescharrues.asso.fr/2017/
[5] http://festival-fetedubruit.com/
[6] http://www.grandchampbardement.fr/
[7] http://www.lestrans.com/
Crédits photos : Philippe Cuvelette, Eileen MORIZUR, Seb Mermin, Inconnu, Philippe Cuvelette