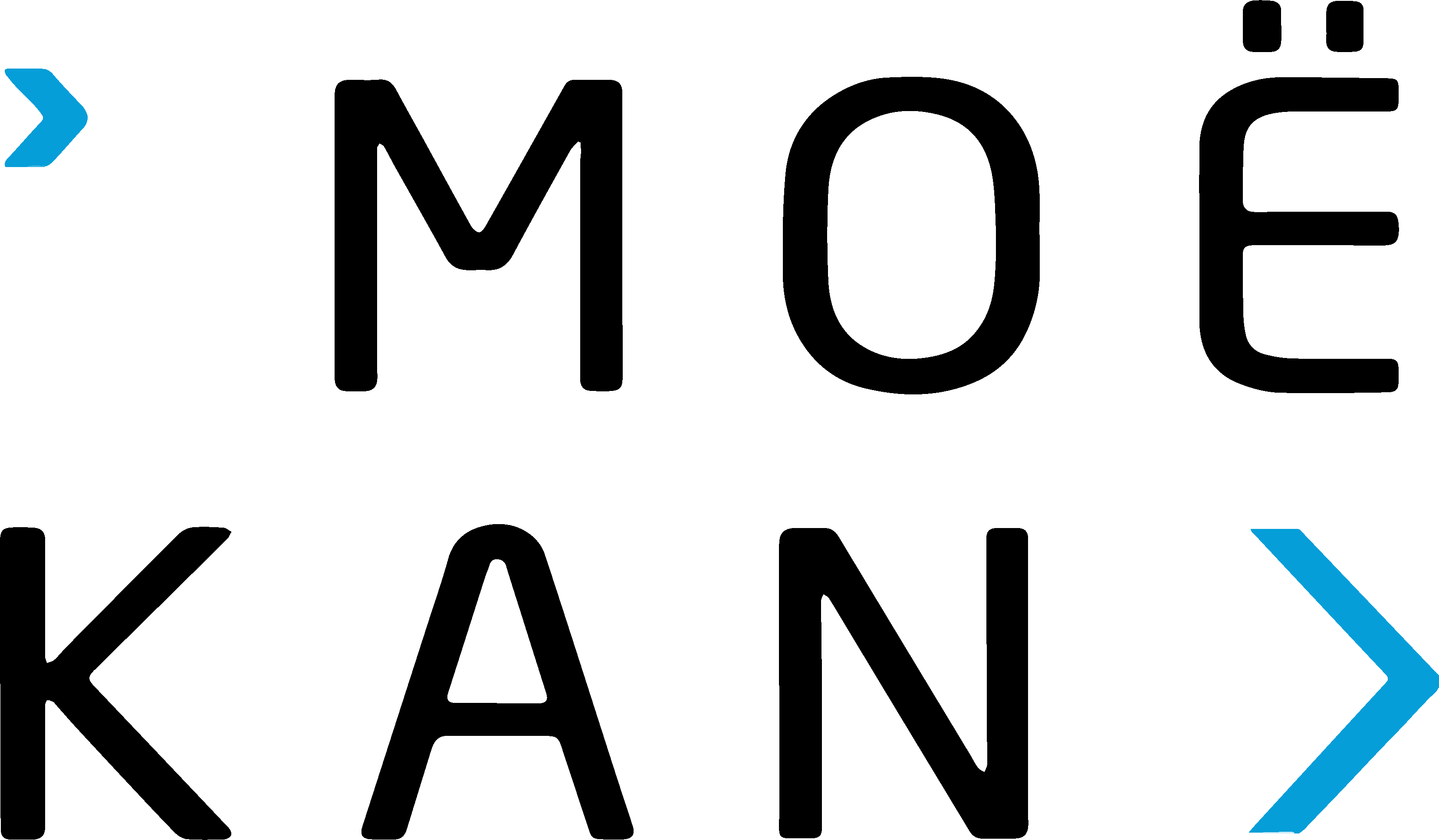Grégoire Harel est le directeur de la Faïencerie, théâtre situé à Creil et lieu incontournable du spectacle vivant des Hauts de France. Il nous explique ici qu’il n’est pas que cela. Fort de son expérience atypique, il nous offre sa vision sans concession de ses missions et de l’évolution de la culture.
Grégoire Harel est le directeur de la Faïencerie, théâtre situé à Creil et lieu incontournable du spectacle vivant des Hauts de France. Il nous explique ici qu’il n’est pas que cela. Fort de son expérience atypique, il nous offre sa vision sans concession de ses missions et de l’évolution de la culture.
Moe-Kan : Nous aimons bien commencer nos interviews en demandant à nos interlocuteurs de se présenter. Je t’en prie.
Grégoire Harel : Je me présente, en général, en disant que j’ai deux métiers : un métier le jour, et un métier la nuit. Un métier subventionné à 80% et un métier qui ne l’est pas du tout. Ces deux métiers sont à la fois complémentaires et intéressants. Le métier de jour, c’est directeur de théâtre, le métier subventionné à 80%. Et le métier de la nuit, c’est fondateur de la plateforme web Proarti[1], une structure qui n’est pas subventionnée. J’exerce cette seconde activité bénévolement.
Le théâtre est une entité conventionnée, locale, opérationnelle dans le domaine du spectacle vivant. A l’inverse, Proarti est une entité sans frontière, plutôt « startup » de la culture, ancrée dans l’économie sociale et solidaire, dans le domaine du mécénat et du financement participatif.
Dans les faits, mon énergie et mon temps sont, bien sûr, consacrés principalement à la Faïencerie[2], Proarti m’occupant durant les interstices, week-end et vacances.
Ces deux activités forment un tout car, auparavant, j’ai travaillé dans de grosses machines culturelles, dont la Cité des sciences et de l’industrie.
J’y ai appris les enjeux de la gestion d’un musée d’une part, et, d’autre part, les difficultés intrinsèques à une grosse fusion puisque j’y travaillais durant la fusion de la Cité des sciences et du Palais de la découverte. En outre, j’ai également appris la difficulté de gérer une entreprise dans laquelle beaucoup de salariés étaient là depuis très longtemps, des personnes qui avaient apporté un fort engagement professionnel au début, puis avaient connu une forme d’usure, et donc une souffrance liée à des situations humaines délicates.
Cela m’a amené à préférer travailler pour des petites structures. Et quitte à mouiller la chemise, autant le faire pour un secteur qui me passionne davantage, à savoir le spectacle vivant.
Si on remonte encore le temps, j’ai administré une saison culturelle à l’Institut français, qui s’appelait, à l’époque, Culture France. Expérience intéressante bien que peu visible, car intégrée dans un ensemble européen beaucoup plus large.
J’ai également vécu deux autres expériences fondatrices dans l’administration. La dernière au Ministère des affaires étrangères sur des questions européennes, et la première à la Mairie de Paris sur des questions de spectacle vivant et de cinéma. J’étais responsable du bureau du théâtre, de la danse et du cinéma au sein de la direction des affaires culturelles de la mairie de Paris.
Moe-Kan : Ce parcours que tu as évoqué à rebours s’étale sur une amplitude de combien d’années ?
Grégoire Harel : De 1998 à aujourd’hui.
MK : Et en formation initiale ?
GH : Science Po, Cambridge, et ENA.
Le développement plutôt que la gestion.
MK : Avec ce parcours, quand tu entames ta première expérience à la Mairie de Paris, quel est ton projet ?
GH : A l’époque, je n’ai pas encore de projet clairement défini. Je suis cependant déjà dans une logique de développement plutôt que de gestion courante, dans une logique de mission plutôt que de gestion. Dans l’administration, les métiers de mission sont plutôt cachés par rapport à ceux de gestion. C’est sans doute pour cela que j’ai intégré une collectivité locale, plus dans une logique de terrain et d’action que l’Etat, même s’il existe des contre-exemples.
MK : Depuis que nous nous sommes rencontrés, il est clair que nous n’avons pas la sensation d’avoir affaire à quelqu’un qui s’est posé, mais plutôt à quelqu’un qui cherche à développer des projets, à mettre les choses en mouvement.
GH : C’est un de mes fils rouge. Un autre de mes fils rouges est la conduite du changement. Je me missionne moi-même sur la conduite du changement, même lorsque je ne suis pas missionné pour cela. Je ne fais quasiment que cela à Creil, même si ce n’est pas ma mission première.
Dès mon premier emploi, j’ai mis en mouvement des personnes qui avaient arrêté de bouger. Je les ai amenées à évoluer, parfois un peu contre leur gré, mais toujours en respectant leur tempo et leur choix ou non de jouer le jeu, et donc la possibilité de trouver un terrain d’entente. Evidemment, tout cela en donnant à chacun le temps, et en tenant compte des éventuels blocages.
Enfin, je suis toujours dans une logique de remise en question et de prise de risques.
MK : qu’entends-tu par remise en question ?
GH : Lorsque tu t’occupes depuis 5 ans de la tutelle d’établissement public de diffusion de spectacle vivant, organisation d’opération dans le domaine spectacle vivant, accompagnement d’une politique publique culturelle dans le domaine du spectacle vivant et un peu du cinéma, et que, du jour au lendemain, tu te retrouves à aller travailler pour le conseil de l’Union Européenne sur l’Union économique et monétaire, le fonctionnement de la banque centrale de l’Union, ce n’est pas un petit changement !
Une rencontre tardive avec l’artistique
MK : Donc, c’est cela le lien entre tes différentes aventures professionnelles, et pas le spectacle vivant ?
GH : Disons que, dans l’ordre, j’avais plutôt envie de travailler dans la diplomatie, puis est né l’envie de travailler dans la culture. J’ai réalisé cela dans le désordre. J’ai d’abord travaillé dans la culture, puis dans la diplomatie, puis à nouveau dans la culture. Je sais pourquoi je voulais travailler dans la diplomatie, et je sais pourquoi je l’ai quitté. J’ai également compris, mais après plus de temps, pourquoi j’ai travaillé sur les questions européennes par opposition à une vision plus traditionnelle de la diplomatie. Pour résumer, j’aime l’économie et tout ce qui a trait à la dimension internationale et la mondialisation, non pour la subir mais pour la comprendre et l’humaniser. On est loin de la culture, mais tu peux assez vite reconnecter les choses finalement.
Mon passage au Quai d’Orsay a été pour moi un bon endroit pour étudier pourquoi la culture est totalement absente de toutes les questions fondamentales des relations dans l’Union Européenne.
MK : Dans ton parcours, tu évoques la culture mais pas les artistes. As-tu vécu des rencontres particulières ?
GH : La rencontre s’est faite tardivement. Ma famille ne m’a rien transmis de ce côté. En devenant étudiant provincial à Paris, j’ai découvert la culture au travers de rencontre de personnes baignées dans des milieux qui y étaient plus ouverts. Par la suite, j’ai également rencontré mon ami qui est comédien, ce qui n’est pas anodin. Tout cela m’a influencé dans le fait d’oser en faire mon métier. Rencontrer un artiste m’a permis de réaliser qu’il était possible, nonobstant mes études, d’aller raccrocher ce secteur. J’ai alors découvert qu’il y avait des métiers de la culture.
Je suis différent des personnes qui ont eu une pratique artistique amateure durant leur jeunesse, ou eu dans leur famille des parents artistes. Mon premier boulot à la Mairie de Paris m’a vraiment formé. Dans ce cadre, j’ai pu voir tout, et tout le monde.
MK : Donc aucune expérience de plateau ?
GH : Non, aucune ! Se retrouver à diriger un théâtre sans avoir eu aucune expérience de plateau, c’est quelque chose ! D’une part, tu dois affronter le regard des professionnels sur toi et, d’autre part, il te manque, malgré tout, un pan d’expérience.
 MK : Est-ce que le public qui fréquente la Faïencerie a changé depuis 5 ans ?
MK : Est-ce que le public qui fréquente la Faïencerie a changé depuis 5 ans ?
GH : Je pense qu’il a un peu changé. Il a d’abord tendance à se raréfier. Ce n’est pas catastrophique, mais j’ai le sentiment que nous sommes clairement confrontés à une crise de public qui est liée à une crise sociologique. Elle est elle-même liée à une crise économique et sociale propre à Creil. Les classes moyennes un peu « plus, plus » sont en train, je pense, de fuir Creil. C’est un sujet. Une fois qu’elles sont à 5, 10 ou 20 kilomètres, elles se posent la question de leur relation avec le Théâtre. Cette évolution est alarmante. C’est un signe de plein de choses, qui relèvent de la politique, de l’aménagement du territoire…
Ensuite, je perçois qu’il y a un certain rajeunissement à certains endroits de la programmation. C’est léger, mais c’est fragile. Ces jeunes, puisqu’ils n’ont pas véritablement de perspectives locales, seront difficiles à garder avec nous une fois qu’ils auront pris le chemin de leur vie. A contrario, certains partent faire leurs études et reviennent sur le territoire.
Toute la stratégie participative que nous avons pu mettre en œuvre à travers différentes actions, les spectacles participatifs, l’intervention du public dans la gestion de la Faïencerie, les ateliers de pratique artistique participatifs, par opposition à des ateliers de pratique artistique pure, tout cela fait que nous avons une diversification du public dans ces moments-là. Par contre, pour schématiser par rapport à la sociologie de Creil, nous sommes quand même confrontés, pour la programmation traditionnelle, au fait que nous n’y voyons pas les minorités visibles. Et ce, malgré le fait que l’on s’adresse de plus en plus directement à tout le monde. Je parle de cela car nous avons, depuis un an, renforcé notre présence sur le terrain. Pour caricaturer, il y a deux trois ans, nous ne serions pas rentrés dans un Kébab du centre de Creil pour aller déposer des flyers sur ce que notre programmation. Aujourd’hui, nous le faisons. Est-ce que cela donne des résultats ? Est-ce que cela aura des résultats sur le moyen terme ? C’est trop tôt pour le dire, mais, en tout cas, nous avons clairement dépassé d’éventuels tabous. Nous allons voir tout le monde et tout le monde nous intéresse. Ce n’est pas que nous avons eu des blocages auparavant ; c’est juste que nous sommes de plus en plus proactifs depuis deux ans, et systématiques depuis un an.
MK : En fait ce n’est pas tout le monde nous intéresse, mais tout le monde est intéressé ou sera intéressé ?
GH : Exactement !
Se reconnecter avec territoire
MK : Votre façon de vous adresser au public passe également par des manifestations hors les murs de la Faïencerie. Quelle est la proportion de ce type de spectacles ?
GH : La proportion d’activités décentralisées est variable. Nous avons connu, ici aussi, deux grands cycles. Elle a eu tendance à diminuer parce que nous étions dans une rationalisation économique. Tant que nous n’avions que de petites baisses de subventions, nous étions dans un processus de rationalisation ordonnée. Nous prenions donc certains risques en nous disant qu’un euro injecté sur le grand plateau de la Faïencerie, si la salle est plein à 75% (son taux de remplissage moyen), c’est un euro mieux utilisé, pour contenter plus de monde, que pour un spectacle en milieu rural avec une jauge de 100 personnes dans lequel nous allons péniblement réussir à en attirer 35.
Finalement, nous sommes arrivés à une phase de crise dans laquelle nous avons dû faire face à une rationalisation qui n’était plus ordonnée. Nous y sommes encore. Je considère aujourd’hui que nous n’avons plus les moyens financiers de faire tourner le plateau de Creil. C’est un triste constat d’échec. Je suis donc en train de renverser la vapeur et la tendance. Du coup, comme nous en avons encore les moyens, nous emmenons plus de petites formes sur le territoire. Je suis en train de réorienter notre activité dans cette direction. Au moins, c’est quelque chose que nous avons encore les moyens de faire avec notre économie.
Cela peut paraitre paradoxal, mais à partir du moment où nous n’avons plus les moyens de faire venir des formes qui permettent d’habiter le plateau de Creil, et que d’autres formes ont un ou deux artistes qui y paraitraient peu adaptées, alors, nous allons au-devant du public avec.
Il n’y a cependant pas qu’une logique économique. Par ailleurs, nous avons mesuré, à l’occasion de cette crise économique que nous nous étions trop déconnectés du territoire.
Autre élément d’analyse, la mutation que nous avons connue en allant opérer un nouveau théâtre à Chambly (à 25 kms de Creil) nous a amené à prendre conscience que nous pouvions prendre part à un enjeu d’aménagement du territoire. Nous nous sommes-rendu compte que nous étions capables de le faire, d’être multisites. Nous sommes beaucoup plus à l’aise sur ce sujet aujourd’hui.
Enfin, la crise financière a amené le public à réagir. Il a lancé une pétition, des démarches sur lesquelles je n’étais pas un élément moteur. J’ai découvert que cette mobilisation se connectait avec un ressenti d’abandon de la population, de cette poche du sud l’Oise qui est économiquement complétement dépendante et tournée vers l’île de France et Paris ; et, en même temps, très éloignée de la métropole lilloise et d’Amiens. Ces personnes se sentent complétement abandonnées au niveau des transports, des écoles et de la culture. Ceux qui ont mis en place, et signé la pétition, ont fait le lien. Tout cela justifie le fait d’aller vers le territoire.
Des relations compliquées avec la municipalité
MK : J’aurai bien aimé que tu qualifies la Faïencerie, en termes d’effectif plateau, de personnel etc.
GH : La Faïencerie est une association missionnée par l’Etat, la Région, le Département et la ville de Creil pour mettre en place la politique du spectacle vivant sur la ville de Creil et bien au-delà. Les moyens : 16 salariés, des espaces différents, un très grand plateau (pour la danse), et la salle de la manufacture, une salle à plat gigantesque avec un potentiel énorme, mais qui nécessite des aménagements pour lesquels nous avons des marges de manœuvre limitées.
Les missions sont claires, les moyens sont clairs lorsqu’on parle des finances puisque nous avons un budget d’1,9 millions d’euros. Tout est donc clair. Mais dès qu’on en arrive sur le bâtiment et les espaces, on arrive dans quelque chose de perverti aujourd’hui. La ville de Creil conteste de fait la libre disposition du bâtiment, et freine le déploiement du projet pour des raisons entendables, mais difficiles à accepter lorsqu’on regarde le projet et l’impact que cela a sur le projet.

ML : Changeons d’angle. Comment s’est déroulée ta première rencontre avec la technique du spectacle ?
GH : J’ai d’abord été confronté à la construction de bâtiments type théâtre avec, derrière, des enjeux techniques. J’ai beaucoup participé au dossier, avec des visites de chantier, des rencontres avec les architectes, etc. Je pense à la rénovation du théâtre de la cité internationale avec comme architecte Philippe Pumain[4]. Je suis intervenu de manière périphérique, mais j’ai pu avoir une vue d’ensemble, donc sur les aspects techniques également.
MK : A quel titre es-tu intervenu dessus ?
GH : Je travaillais pour la Mairie de Paris qui avait financé le projet. C’est d’ailleurs intéressant de voir que dans ce cas, en rencontrant l’architecte, en comprenant les tenants et les aboutissants, j’ai pu participer à un financement impliqué, et pas seulement au financement d’un projet validé ensuite uniquement d’un point de vue politique.
Dans le même registre, il y a eu la création de l’atelier Carolyn Carlson à la Cartoucherie, dans l’enceinte du théâtre du Chaudron. Là, je me suis frotté aux questions du double lambourdage du plancher de danse, des amortisseurs entre les lambourdes, etc.
Je me rappelle également d’une fois où le Théâtre de la Tempête avait fait des travaux sans prévenir la ville, en catimini, pour augmenter la jauge, car ils étaient frustrés de refuser du monde à chaque spectacle. Nous avons dû valider cela a postériori. En même temps, je trouve le principe d’action respectable.
MK : Et après ?
GH : Mon contact avec la technique proprement dite c’est avec le régisseur général de Nuit Blanche ou Paris Plage. Ce sont des rencontres très importantes. Dans ce cadre, je suis entré dans l’environnement de la technique proprement dite avec la fermeture des voies sur berges, l’atterrissage des spectacles sur la voie publique.
MK : Tu arrives ensuite sur le plateau du théâtre de la Faïencerie ?
GH : Exactement.
Des métiers aux caractéristiques communes
MK : Comment regardes-tu ces métiers aujourd’hui ?
GH : Je trouve qu’il existe des points communs dans tous les métiers de la culture. D’abord, c’est d’être sous-payé, ce que j’appelle la « taxe culturelle ». C’est le prix que tu acceptes de laisser sur ta paye pour faire le métier qui tu aimes. Ensuite, c’est le principe du « mouton à cinq pattes », c’est-à-dire le fait d’être amené à gérer des diversités de situations, de besoins, de qualités professionnelles ou de compétences, qui me semblent très rares. Par exemple, le fait que quelqu’un qui s’occupe des RP doive rentrer dans la technique de l’Education Nationale, dans du marketing, dans du travail avec le champ associatif, d’être dans la conception, l’exécution opérationnelle, la relation avec les artistes, l’analyse d’une œuvre artistique pour pouvoir la retranscrire dans des mots simples, le contact avec le public, la fidélisation du public. Tu te rends compte du nombre de compétences qu’il faut réunir ? Il faut savoir s’exprimer en public, savoir faire une synthèse, savoir aller chercher de l’argent, remplir des dossiers, remplir des budgets, faire le suivi budgétaire…
Tu transposes cela à la technique, c’est exactement la même chose. Il faut maitriser l’évolution technique, le numérique, les nouveaux outils, etc. En même temps, ce sont des artisans, il faut du bon sens, ce sont également des métiers physiques, à risque, etc. je trouve qu’il y a un étirement des compétences où il faut à la fois maitriser des logiciels et en même temps, savoir faire des études de coûts et des régies au sens cinéma, c’est-à-dire trouver des solutions pour que cela ait lieu à l’instant « t », en mode débrouille. Et en même temps le côté RH, management, budgétaire, etc.
Chaque service, dont la technique se retrouve à être une petite entreprise qui est confrontée à des sujets RH, budgétaires, d’organisation complexe, et une adaptation à des contraintes horaires parfois compliquées.
MK : Comme tu as pu être interpelé par des artistes par ce qu’ils sont en tant qu’êtres humains, ou par ce qu’ils produisent artistiquement, gardes-tu en mémoire des techniciens de la même manière ?
GH : Oui. Les directeurs techniques, sans aucun doute. L’ancien DT du théâtre de la ville, l’historique DT, est quelqu’un auprès de qui j’ai beaucoup appris. Le DT des bouffes du nord, de la même manière. Le régisseur général avec lequel nous avons fait Nuit Blanche et Paris Plage… Je n’ai pas forcément tous les noms en tête, mais j’ai le souvenir de personnes qui te bluffent, dans le bon sens du terme.
Situer le risque au bon endroit
MK : A partir de quel moment rencontres-tu le domaine de la prévention des risques dans ton parcours ?
GH : C’est avec mon arrivée à la Faïencerie que ma confrontation à la prévention des risques a vraiment eu lieu.
MK : C’est donc avec ton expérience d’entrepreneur de spectacle vivant et l’obtention de la licence qui passe par une formation ?
GH : Effectivement, c’est une obligation mais elle a été extrêmement positive.
MK : Tu n’y avais pas été confronté avant ?
GH : Si, mais de manière indirecte. Dans le cadre de Nuit Blanche ou Paris Plage, les aspects concernant les dossiers pour la Préfecture, les autorisations, etc. étaient délégués à une structure. Je n’ai suivi cela que de très loin. Je l’ai supervisé, mais je ne l’ai pas vraiment vécu. J’en subissais les conséquences, les délais de la préfecture, les décisions de la préfecture, mais je ne l’ai pas vécu en me sentant directement responsable.
Aujourd’hui je me sens réellement responsable des salariés et du public. Je ne suis pas seul. Le président m’a délégué en grande partie cette responsabilité même s’il reste responsable, et moi je l’ai déléguée en grande partie à Jean Christophe, le DT de la Faïencerie, même si je reste responsable.
 MK : Et tu en penses quoi aujourd’hui, eut égard le contexte ?
MK : Et tu en penses quoi aujourd’hui, eut égard le contexte ?
GH : je trouve que c’est une profession qui gère très bien le risque. Si tu n’as pas cette dimension en tête, tu ne comprends pas certains reflexes qu’ont les techniciens. Je trouve que c’est une profession qui situe le risque au bon endroit. Elle s’est globalement formée, elle gère les risques en permanence en situation de contrainte avec cette obligation de résultat, et, en même temps, elle prend des risques qu’elle assume. Nous ne sommes pas dans une profession qui aurait fait passer un principe de précaution très procédurier au premier plan. Nous n’en sommes pas du tout là.
MK : Cette corporation a compris que « faire », c’est prendre un risque, et donc il faut le regarder en face ?
GH : Oui, parce qu’elle reste animée par le respect de la rencontre de l’artiste et du public. On pourrait parler des heures de la relation entre les techniciens et les artistes, ou de celle entre les artistes et le public. Par contre, la relation entre les techniciens et le public, ce serait intéressant, mais j’aurai moins de choses à dire. Je pense que s’il existe un truc à améliorer dans la manière qu’ont les techniciens à penser leur travail et leur mission sur le long terme, c’est clairement la relation au public. C’est un vrai manque.
MK : Un manque d’interrogation des techniciens sur qu’est ce que le public, que fait-il là ? pourquoi il vient ?
GH : Je pense que c’est indispensable, pour l’expérimenter, de faire monter le public sur le plateau, et pas juste dans une visite du théâtre lorsqu’il n’y a pas d’activité.
Ensuite, ma crainte c’est que les techniciens ne parviennent plus à être emportés comme le public par le spectacle. Lorsque je vois un technicien qui ne pense qu’à regarder ses sms ou ses mails pendant un spectacle, ou pire, regarder des séries télé pendant un spectacle, cela me met en colère.
MK : On peut se poser la question de pourquoi cela arrive. Parfois, certains évoquent le fait de rester en éveil ! Si tu avais quelque chose dire à quelqu’un qui souhaite rentrer dans une fonction managériale au sein du secteur du spectacle vivant dans le domaine de la technique ?
Le oui comme a priori
GH : Je vais dire des banalités, mais la première chose serait de garder une âme d’enfant. Une forme de générosité et d’ouverture par rapport aux aventures singulières auxquelles il va être confronté. Je pense que nous sommes des intendants au sens noble du terme. Il faut garder l’envie d’être joueur. Et puis, commencer toujours à réfléchir avant de dire non, voire de bannir le « non ». Cela ne veut pas dire se laisser marcher sur les pieds. N’empêche, il faut garder le « oui » comme a priori. J’ai besoin de travailler avec des gens dont l’état d’esprit, a priori, est de dire oui.
Pour conclure, je suis inquiet pour notre milieu, notre secteur, par la relation public/privé dans le secteur. Le libéralisme est un sujet intéressant, mais l’impact des libéralismes dans les relations humaines, le fonctionnement de la société me fait peur. Tout cela est à contre-courant des valeurs du spectacle vivant. Comme je constate l’emprise croissante du libéralisme dans la société, je suis inquiet pour le spectacle vivant.
MK : Nous avons déjà vécu des époques où le spectacle vivant était inquiet, mais il a changé, peut-être s’est-il adapté en tant que nécessité vitale ? Il a été modifié mais est toujours-là.
GH : Certes, mais croises-tu aujourd’hui des gens qui disent « je crois ». « Je crois dans la culture ». Personnellement, je n’en croise pas beaucoup, et ceux-là travaillent souvent dans le spectacle vivant.
En tout cas je n’envisage plus de diriger un théâtre comme un lieu qui sert juste à accueillir des spectacles en soirée. Je ne veux plus travailler pour un lieu fermé sur lui-même mais dans un lieu ouvert au public. Cela précipitera sans doute mon départ de la ville de Creil qui n’est malheureusement pas dans cette optique.
[2] http://faiencerie-theatre.com/
[3] https://fr.wikipedia.org/wiki/Carolyn_Carlson
[4] Voir, par exemple http://www.lecourrierdelarchitecte.com/article_5804
Crédits photos : Philippe Cuvelette