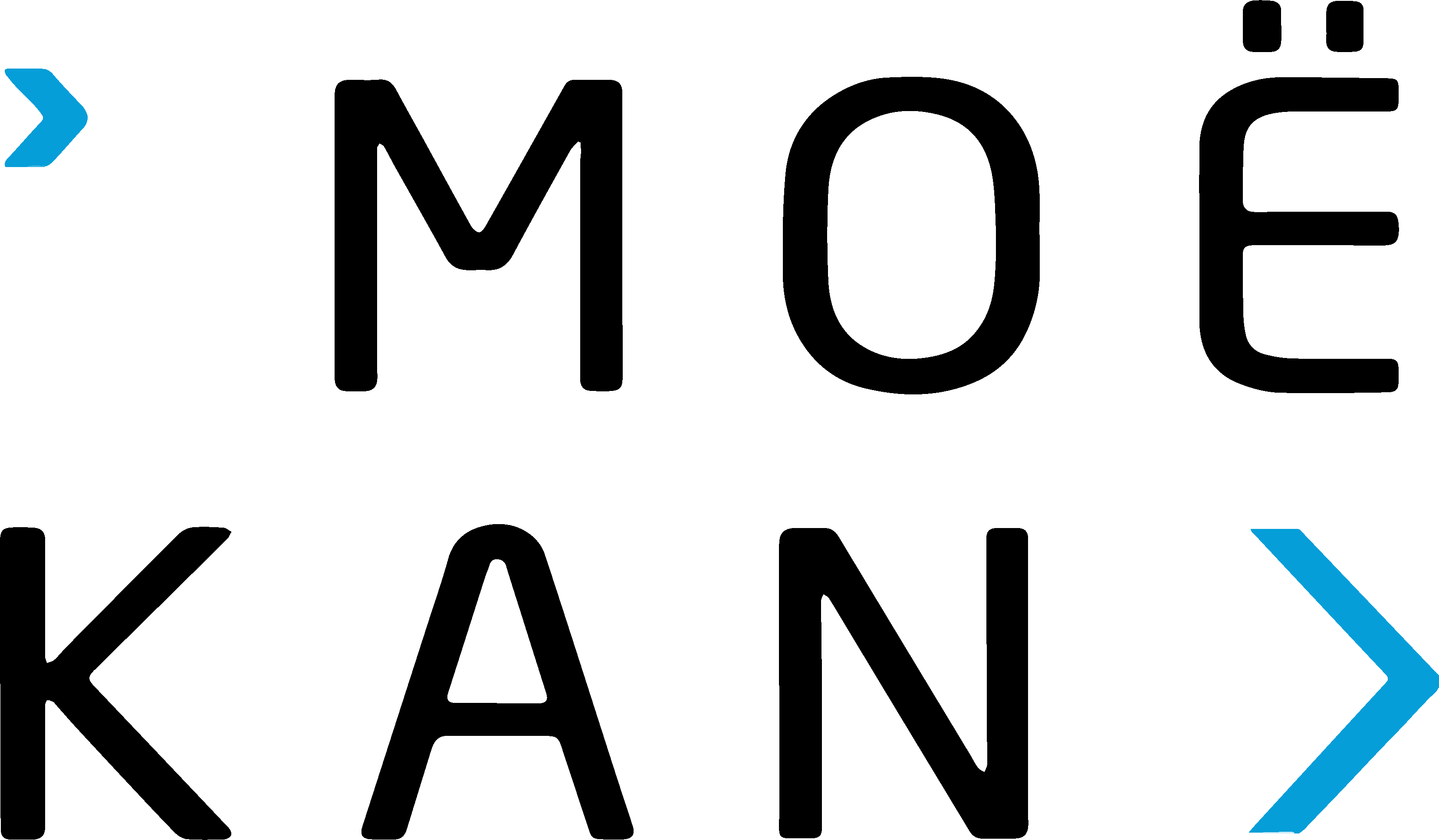Baptiste Reverdiau, rédacteur en chef de la Gazette, a bien voulu partager son expérience professionnelle. Avec son franc-parler, il nous dresse un bilan sur le métier du technicien de spectacle en le replaçant dans sa dimension historique. Il nous explique également ce qui a motivé, ou influencé, ses choix professionnels, qui constituent le socle de ses actuelles réflexions.
Le tabou du technicien
 Moë-Kan : Nous voulions revenir sur ta participation à la Gazette et sur l’édito que tu as écrit pour le premier numéro. Pourquoi as-tu été intéressé, par rapport à tout ce que tu nous a raconté jusque-là, par notre proposition ? Est-ce l’idée de transmission, de valorisation, comme tu l’as évoqué ?
Moë-Kan : Nous voulions revenir sur ta participation à la Gazette et sur l’édito que tu as écrit pour le premier numéro. Pourquoi as-tu été intéressé, par rapport à tout ce que tu nous a raconté jusque-là, par notre proposition ? Est-ce l’idée de transmission, de valorisation, comme tu l’as évoqué ?
Baptiste Reverdiau : Je ne connais pas d’ouvrage qui portent sur les motivations profondes des techniciens. Évoquons tout de même Louis Jouvet (qui avait été machiniste et régisseur avant d’être comédien). Il faut lire sa préface à Sabbattini[1]. Il y parle admirablement du technicien.
Ces métiers sont caractérisés par un tabou : le technicien, on ne le voit pas, il doit rester caché (au point que, lorsqu’on l’enfreint, on doit payer : c’est la prime de feu). Si tu as un noir, les gamelles à 2% pour faire un gros changement de décor, le technicien touche sa prime. Il ne faut donc pas s’étonner que parler des techniciens, c’est compliqué, vu qu’ils passent leur temps à se cacher.
C’est pareil avec le décor. On passe notre temps à faire de magnifiques décors ou l’envers est caché : on ne voit pas la colle et les clous, soit, mais encore moins les prodiges d’ingéniosité qu’il recèle. Eh bien dans le spectacle, on ne voit pas le technicien et donc, on n’en parle pas. Il faut quelqu’un comme Sophie Cathala, pour qu’une étude soit réalisée sur les techniciens.[2]
Moë-Kan : C’est vrai qu’en dehors de cet exemple, il n’existe aucun regard sur qui sont les techniciens du spectacle.
BR : Et en même temps pour mener une telle étude, il faut être du milieu : les techniciens ne souhaitent pas parler d’eux, sinon entre eux. En plus, dans le milieu du spectacle français, on ne publie pas. En France, s’il existe quelques ouvrages sur la lumière ou sur le son, les ouvrages sur la machinerie ou le décor sont rares. Il faut aller à l’étranger pour trouver des publications, rarement traduites en français. Pourquoi ne trouve-t-on pas plus d’ouvrages sur les questions que je pose dans l’édito ? Je ne sais pas.
Moë-Kan : Est-ce qu’avec la structuration des organisations du spectacle en entreprise, avec notamment des services de ressources humaines, ces questions sont désormais posées ?
BR : Non. Le directeur de ressources humaines se moque de savoir pourquoi les techniciens du spectacle ont choisis cette voie. Ce qui lui importe, c’est d’avoir des salariés efficaces et rentables.
Un besoin d’images communes
 Moë-Kan : Les questions posées dans l’édito restent donc pertinentes ?
Moë-Kan : Les questions posées dans l’édito restent donc pertinentes ?
BR : Oui. Mais ce sont des questions que l’on ne se pose pas à vingt ans. Il faut avoir accumulé une certaine expérience et avoir un certain recul. Il me semble qu’à vingt ans, on ne se pose pas de questions fondamentales sur son métier. Si on interroge les CFA sur ces questions, on n’aura pas de réponses qui parleront d’eux. Les réponses concerneront les métiers ou l’image qu’ils en ont aujourd’hui.
Mais ces questions sont nécessaires pour comprendre pourquoi, depuis au moins huit ou dix mille ans, le spectacle est indispensable. Pour en saisir la raison, on ne peut se contenter d’interroger les spectateurs. Tu fais dévorer des condamnées par les lions, le spectateur vient. Tu lui donnes Johnny Halliday, il vient. Tu mets vingt mecs autour d’un ballon, il vient. Du moment qu’il participe à regroupement de 15000 personnes, il vient. Tu peux lui mettre n’importe quoi en spectacle, il vient.
Mais sur le fait que des gens jouent à ça, en se disant, comme des enfants : « Toi tu seras la crémière, toi le boulanger », il faut les interroger eux. Quand des enfants qui jouent à ceci ou à cela, un autre enfant passant à proximité intéressé par le jeu ne se contentera pas de jouer le rôle du spectateur : il rentre dans le jeu à son tour. Si ce sont des adultes, non, à l’exception précisément des artistes et des techniciens.
Pourquoi donc des adultes se prêtent à ce jeu ? Pour échapper à la réalité ? Je ne sais pas.
Mais on peut trouver une piste en rapprochant la messe et le théâtre. A la messe, tu as un officiant qui donne une représentation à tous les autres qui lui font face et qui se taisent, le tout dans un espace fermé. Cela a dû commencé il y a bien longtemps dans les grottes. Et les églises romanes et gothiques sont conçues sur ce modèle. Nous avons sans doute besoin d’images symboliques qui structurent le groupe et de lieux consacrés.
Parfois, tu es secoué par un spectacle, même si tu connais le texte. Il y a donc autre chose, une sorte de fusion, une sorte de miracle qui fait qu’on s’attache au spectacle vivant.
Moë-Kan : D’accord, mais ce que tu évoques, c’est du côté public.
BR : Oui, mais de l’autre côté, le curé, lui, il joue un rôle, il met un costume. Cela commence au Néolithique. Au même moment que la société se structure dans sa forme actuelle, avec sa hiérarchisation et tout ce qui s’ensuit… Les inégalités, les clôtures autour des cultures, les guerres …
Le miracle du spectacle vivant
Moë-Kan : Aujourd’hui, si on observe le climat social dans le monde de la culture en France, on entend qu’en réduisant les budgets encore et encore, on met en péril des lieux de spectacles, et que, de cela, on peut mourir.
BR : Parce qu’il y a une dimension spirituelle. Et en même temps, le théâtre, comme la messe (et désormais la campagne politique, qui reprend les recettes du spectacle), nous donne à entendre les mots que nous attendons : nous allons vers un avenir meilleur (ou pas) mais tous ensemble.
J’imagine que cette dimension spirituelle n’est pas étrangère au fait que des gens que rien ne destine à être des techniciens du spectacle le deviennent. Et bien souvent ils s’avouent incapables d’envisager de quitter le monde du spectacle.
De plus, le spectacle peut s’avérer subversif, et mettre dans la bouche des acteurs, de manière parfois cachée ou détournée, des propos révolutionnaires ou séditieux (rien de nouveau : c’était déjà le cas des messes du début du christianisme). C’est que le spectacle est un miroir des aspirations du collectif. Ce dernier est à la fois celui qui pousse et celui qui attend. Comme dans une séance de spiritisme, où, inconsciemment, tout le monde participe au mouvement de la table tout en attendant les réponses.
Des types dans la combine
 Moë-Kan : Mais le technicien là-dedans, quelle place occupe-t-il ?
Moë-Kan : Mais le technicien là-dedans, quelle place occupe-t-il ?
BR : Ici encore je ne peux que proposer des pistes. Il faut relire Héron d’Alexandrie[3]. Héron explique dans ses Pneumatiques des effets, des trucs mis au point dans les villes de pèlerinages ou d’oracles. Par exemple, comment faire que lorsqu’un individu jette une pièce de cinq drachmes dans la un vase, de l’eau s’écoule de la fontaine pour les ablutions, ou bien encore comment faire pour qu’en allumant un feu sur l’autel, les portes s’ouvrent toutes seules, puis se referment lorsque le feu s’éteint. En fait, il n’est question que de donner l’illusion du miracle (et ce pour capter l’argent du pèlerin : la fortune de Delphes, entre autres, vient de là).
Le théâtre est étroitement lié à la religion et le technicien participe à cette mystification.
Nicola Sabbattini[4] a lu Héron d’Alexandrie, mais il a vécu dans l’Italie de la Renaissance. Il n’est plus exclusivement dans le registre religieux d’Héron d’Alexandrie, pas plus qu’il n’est au servie de l’Etat. Il travaille pour son propre compte et il s’agit pour lui de montrer un spectacle qui raconte des histoires d’hommes.
Moë-Kan : Crois-tu que le technicien qui vient aujourd’hui apprendre le métier, par exemple au CFA, profite de la capitalisation de toute cette histoire que nous venons d’évoquer ?
BR : Il en voit les grandes lignes, mais, de toute façon, on ne peut pas lui donner plus que cela. Au-delà de l’histoire des techniques, la recherche des motivations du technicien reste une quête personnelle. Une piste encore : dans l’excellente Histoire du théâtre dessinée : de la préhistoire à nos jours [5], André Degaine amorce dans quelques petits croquis une hypothèse sur la naissance du spectacle. Il tente de reconstituer comment cela a pu démarrer, et selon moi c’est très bien vu. C’est le résultat d’un lent processus fondé sur une émotion collective, sur un délire collectif.
Le technicien est dans la combine. Il est comme ceux qui servent la messe. Il sait qu’il contribue à une mystification puisqu’il en voit l’envers et qu’il y participe, mais ça n’est pas le problème, puisque n’est dupe que celui qui veut. L’athée peut bien servir la messe et faire appel au curé lorsqu’il sent la mort venir, puisqu’en fin de compte, on ne peut pas se contenter du vide sidéral qui nous entoure. Et puis le technicien reste un être humain avec ses émotions. En coopérant au spectacle, il participe à quelque chose qui le dépasse.
Moë-Kan : Souvent dans les CV, les techniciens préfèrent mettre en avant avec qui ou sur quoi ils ont travaillé plutôt que ce qu’ils y ont fait et pour quelles raisons profondes.
BR : En fait, en faisant cela, le technicien parle plus du monde dans lequel il vit que de lui-même. En remplissant son CV, il cherche à correspondre à une image que l’employeur potentiel recherche.
Mais pour aller plus loin, si on veut répondre à la question de la place du technicien aujourd’hui, il faut remonter aux origines de notre société, au Néolithique semble-t-il. Le spectacle collectif date sans doute, de cette époque. Et il y a toujours eu des types dans la combine.
Le technicien dans les trois fonctions de la société
Moë-Kan : Mais du coup, tu as pu répondre à partir de cette réflexion sur les ressorts qui font qu’il y a des techniciens du spectacle ou bien tu te poses encore des questions ?
BR : les questions restent celles que j’ai indiquées dans l’édito. Qui ? Pourquoi certains et pas les autres ?
Moë-Kan : Ce sont les mêmes aujourd’hui qu’hier, à ton avis ?
BR : Difficile de s’avancer… J’aurais tendance à rechercher des indices dans le passé lointain. L’archéologie nous apprend que, en gros, la structuration de la société nous vient du néolithique et n’a pas fondamentalement changé depuis. Les recherches comparatistes de Georges Dumézil[6] l’on conduit à définir ce qu’il appelle les trois fonctions qu’il a pistées dans toutes les cultures du monde Indo-Européen : la fonction du sacré et de la souveraineté, la fonction guerrière et la fonction de production (quand on dit “Clergé, Noblesse et Tiers Etat, on y est !).
Moë-Kan : D’accord mais dans ces trois fonctions, où mets-tu le technicien ?
BR : Chaque caste est subdivisée en plusieurs sous-ensembles. Il est plutôt, je pense, du côté du manipulateur. Il appartient donc, sans doute, à l’un des sous-groupes, placé le plus bas dans l’échelle, de la fonction du sacré. C’est un comparse, un “baron”, complice du comédien, et c’est sans doute pour cela qu’il doit rester dans l’ombre.
Relever d’une fonction n’implique pas d’être dupe : l’arrière-pensée doit être prise en compte. Chez les religieux, il y en a qui y croient pour de bon, d’autres qui n’y voient qu’intérêt (ceux que Victor Hugo qualifiait d’athées de la nuance catholique, athées véritables, mais prônant la messe pour leurs gens).
Et le spectateur, croit-il vraiment que le décor qu’on lui montre est une espace réel ? Croit-il vraiment au spectre du roi dans Macbeth ?
Moë-Kan : Pour en avoir discuté avec pas mal de personnes, il est souvent évoqué le fait d’être dans un endroit protégé, le plateau, où on peut rêver à une autre façon de voir le monde pour un temps défini.
BR : Certainement. En ce qui me concerne, j’avais surtout l’impression d’avoir trouvé une niche supportable dans notre société. Etre du côté des techniciens, c’était la possibilité de rester en permanence, contrairement au spectateur, dans un monde sans routine, où l’on croise des gens de la même tribu et où tout est possible.
Là où certains recherchent la lumière des projecteurs, sans doute plus valorisante, le technicien préfère rester dans l’ombre. On travaille cependant dans le même endroit.
Je n’ai pas de réponses définitives aux questions que j’ai posées.
Un environnement atypique
 Moë-Kan : Peux-tu nous présenter ton parcours ?
Moë-Kan : Peux-tu nous présenter ton parcours ?
B R : Je suis né en Touraine au début des années cinquante, huit ans après la fin de la guerre. Ma famille vient d’un peu partout. Elle est issue, me semble-t-il, de communautés taisibles[7], du côté de mon père comme de ma mère. Ce fonctionnement communautaire, proche de celui d’une personne morale actuelle, prend son origine au moyen-âge, lorsqu’il fallait repeupler et exploiter des zones désertées suite à des guerres ou des épidémies. Souvent, le nom des hameaux était celui de la famille principale de cette communauté. Cet héritage m’a sans doute influencé.
J’ai passé mes premières années chez ma grand-mère. Puis, très vite, après ce qui m’apparaît comme un court intermède chez mes parents, j’ai connu le pensionnat, à l’époque où le samedi n’était pas plus chômé dans les écoles que dans les usines.
Moë-Kan : Dans le même environnement, les enfants de ton âge ont un parcours similaire, dans le fait d’être élevé en dehors du cadre familial ?
BR : Je ne crois pas. En tout cas, c’est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j’aurai du mal à me faire ma place, dans un monde qui m’apparaissait sans doute hostile. J’étais “le rêveur”… Un spécialiste de l’évasion. Vers l’âge de dix ans, mon père, médecin, m’a envoyé chez un collègue à lui pour un problème de surdité supposé : on m’appelait et je ne répondais pas. L’ORL a rassuré mon père sur mes fonctions auditives.
Quoiqu’il en soit, je ne saurai pas te dire pourquoi j’étais à ce point dans ma bulle, mais j’y étais et j’en étais conscient. Je me suis très vite forgé une réputation d’élève “dans les nuages”, sinon fainéant. J’imagine qu’aujourd’hui, les enfants comme ça, on les soigne.
Moë-Kan : Peut-on y voir là ce qui t’amènera plus tard vers le spectacle ?
BR : Sans doute, et j’y vois la preuve que je n’étais pas un fainéant : tu sais comme moi que par certains côtés, le spectacle, c’est le bagne. La pression physique, et celle s’exerçant sur la cellule familiale induites par ce choix de vie sont importantes. On n’y reste donc pas par hasard ou par goût de la planque. Il faut de véritables raisons de pour se trouver là.
L’apprentissage de la navigation
Moë-Kan : Revenons à tes onze ans à la découverte de la voile si tu le veux bien.
BR : Pétri de littérature issue de la bibliothèque familiale sur des marins, je découvre donc la voile. J’ai demandé à pouvoir en faire en club. J’ai obtenu, assez facilement je dois dire, d’échapper le jeudi après-midi[8] à la sortie des internes du pensionnat qu’on envoyait errer dans un parc sinistre, pour me rendre dans ce club. Je partais donc, après le déjeuner, habillé de mon jeans (autorisation spéciale pour le jeans), et je revenais le soir, le jeans trempé jusqu’à la ceinture.
J’ai continué dans ce club jusque l’âge de quinze ans, j’y ai appris, très vite, avec quelqu’un que j’aimais beaucoup, plus de la moitié des connaissances qui m’ont été nécessaires pour naviguer par la suite.
En hiver, lorsque la navigation était impossible, on se repliait dans une salle où on faisait du matelotage. C’est là que j’ai appris les nœuds, le matelotage, les videlles que j’ai utilisés par la suite sur le plateau.
Moë-Kan : Pas de contact avec le spectacle jusque-là ?
BR : Non, à part la fête du collège, où un professeur de philosophie montait des pièces de théâtres d’une excellente qualité, jouées par les élèves de terminale, mais à part ça, rien. Mes parents étaient des mordus de cinéma (le premier cinéma était à trente km), mais n’allaient jamais au théâtre.
Si, tout de même, j’ai un souvenir très précis d’une double page, dans un livre intitulé jeux et loisirs de la jeunesse[9] de chez Larousse, qui représentait l’éclaté d’un théâtre avec frises et pendrillons à l’italienne, et qui m’avait bien branché, sans pouvoir dire pourquoi. Faut dire qu’à l’époque les images étaient rares et on n’en trouvait que dans les livres et les tablettes de chocolat. Le goût m’est resté pour les deux.
Le théâtre par hasard
Moë-Kan : Un peu comme ce que l’on trouvait dans les premières éditions de Lumières pour le spectacle, non ?
BR : Oui. En tout cas, cette double page m’a marqué. Et, quand par la suite je suis rentré pour la première fois dans un théâtre, j’avais encore cette image en tête. Entre-temps, j’étais passé par la voile et par un apprentissage en menuiserie et j’étais solidement armé pour la machinerie.
Mais ce n’est pas la curiosité qui m’a amené au théâtre, ce n’est pas d’avoir vu des spectacles non plus, c’est un concours de circonstances, et j’y suis entré par la porte de derrière : dix ans après avoir passé le bac et avoir roulé un peu ma bosse, mon bateau était amarré dans le port de La Rochelle. Un jour, j’ai manqué de me faire écraser par une voiture en tentant de protéger mon chien. Le conducteur était un copain avec lequel j’avais passé mon bac. Il travaillait au théâtre.
Il m’a emmené au restaurant où mangeaient les machinos. J’ai sympathisé. Daniel, le chef machino, m’a présenté son théâtre. Il m’a expliqué rapidement comment cela fonctionnait. Pour moi, c’était la même chose qu’un bateau et Daniel connaissait bien la filiation entre la technique maritime et la technique du théâtre. Peu après, il m’a proposé de travailler trois jours par-ci, deux jours par-là. Cela m’a permis de compléter les moments où je faisais du charter avec mon bateau. Les cachets étaient intéressants et, en peu de temps, je suis devenu celui qu’on appelait dès qu’il y avait un boulot spécial.
Le décor comme champ d’expression
 Le théâtre était équipé d’un atelier de construction plein de machines-outils, mais aucun machino ne savait s’en servir. Je me souviens qu’une fois, compte tenu de ma formation en menuiserie, le régisseur général de l’époque m’a demandé de lui faire des praticables pour l’après-midi même. Je me suis exécuté en lui en faisant ça à l’ancienne, tenons, mortaises, chevilles, chanfreins arrêtés, etc. Il en est tombé sur le cul. Mon apprentissage sérieux en menuiserie m’avait donné des bases solides pour la construction.
Le théâtre était équipé d’un atelier de construction plein de machines-outils, mais aucun machino ne savait s’en servir. Je me souviens qu’une fois, compte tenu de ma formation en menuiserie, le régisseur général de l’époque m’a demandé de lui faire des praticables pour l’après-midi même. Je me suis exécuté en lui en faisant ça à l’ancienne, tenons, mortaises, chevilles, chanfreins arrêtés, etc. Il en est tombé sur le cul. Mon apprentissage sérieux en menuiserie m’avait donné des bases solides pour la construction.
J’avais eu, en effet, la chance de faire mon apprentissage avec patron admirable qui m’a tout appris de la technique avec, en supplément, le goût de faire des choses comme il faut. Si j’avais dû continuer dans cette branche, c’est avec lui que je l’aurais fait, mais je savais déjà que j’allais rapidement m’ennuyer à faire des portes et des fenêtres au kilomètre. D’où la navigation mais également, ensuite, mon goût pour le décor. Le décor, c’est l’aventure : jamais deux fois la même chose, chaque fois un monde nouveau, et tout ça avec des collègues passionnés : jamais seul, jamais battu.
Parallèlement au théâtre, j’ai continué à naviguer, je suis, entre autres, parti à l’étranger, Venezuela, Antilles etc. Lorsque j’ai finalement débarqué, en 84, j’ai demandé à un éclairagiste que je connaissais des adresses de boîtes de construction décors. Il m’a donné deux adresses. J’ai appelé la première de la liste, Manudécors. Le patron, Manu m’a simplement demandé si je savais faire une fenêtre. J’ai été embauché pour une semaine et j’y suis resté dix ans.
C’était la société qui montait dans le milieu. Le patron avait un œil extraordinaire et savait constituer des équipes. C’est une expérience centrale dans ma vie professionnelle. Et tous ceux qui ont vécu cette aventure en sont restés marqués.
J’ai quitté Manudécors et Paris en 94, principalement parce que je voulais changer de rythme et voir ma fille tous les soirs.
En tout cas, qu’il s’agisse de décor, de théâtre, de menuiserie ou de voile, j’aurai pu y rencontrer des gens détestables et je serai parti. Or, à chaque fois, je suis tombé sur un type dont je me suis dit : “Banco, je reste !”
Rétrospectivement je dois dire que j’ai eu de la chance et je n’hésite jamais à prévenir les jeunes techniciens que, que tu sois au théâtre en fixe, ou que tu partes en tournée, quoi que tu fasses, si tu ne le fais pas avec des gens avec qui tu aimes travailler, laisse tomber, c’est trop dur !
Valorisé par son travail
Moë-Kan : On peut penser que, puisque la voile, ta première passion, est une pratique solitaire comparée au plateau qui est une pratique solidaire, n’y es-tu pas venu chercher cela ?
BR : Oui, sans doute, mais la navigation n’est pas nécessairement une pratique solitaire ! Jusqu’à ce que je fasse mon apprentissage en menuiserie, je ne savais vraiment pas comment je pourrai m’insérer dans la société, je ne comprenais pas ce que je faisais là. C’est avec la menuiserie que j’ai commencé à voir de la lumière au bout du tunnel. Je me souviens mon patron me montrant à sa manière (il n’était pas du genre à féliciter) sa satisfaction la première fois pour un meuble que j’avais fabriqué sous ses ordres. Quand nous avons livré le meuble, j’ai vu dans ses yeux que je n’étais pas une merde. Je me suis dit que des gens pouvaient apprécier ce que je faisais.
Moë-Kan : Effectivement très tôt, nous avons eu également l’impression de participer, dans le milieu du spectacle à quelque chose d’extraordinaire qui nous donne une valeur et pas de la valeur. Bien que nous ne soyons qu’un élément de cette chaîne, nous sommes partie prenante de quelque chose d’extraordinaire. Quelqu’un qui reconnaît le travail de ce jeune apprenti en menuiserie, on s’en étonne alors que cela devrait être normal. En fait, c’est l’idée qu’on réussit ensemble, tout en étant chacun à sa place.
BR : Oui. Mais dans cette histoire, c’est surtout que cet événement m’a permis de m’éveiller au fait que je n’étais pas une merde, que j’avais un avenir. Je pouvais déjà être autre chose que le dernier des derniers ; j’ai retrouvé la même chose dans le théâtre et dans la construction de décors.
Moë-Kan : Mais l’enseignement que tu as longuement suivi en pension, est-ce qu’il favorise l’individu ?
BR : Il met la barre très haut, il est très exigeant en travail, et on y cultive l’esprit de compétition. Mais ce que j’ai trouvé dans la menuiserie puis dans la construction de décor, c’est que je n’étais plus seul c’est que tu peux ressentir des émotions professionnelles fortes lorsque tu sors un truc énorme à dix ou vingt personnes. Je mets les non-initiés au défi d’imaginer ce que dix ou vingt personnes qui s’entendent peuvent réaliser en quinze jours.
Du décor à la régie
Moë-Kan : Peut-on en revenir à 1993 lorsque tu quittes Manudécors ?
BR : Je quitte Manu avec regrets et je quitte Paris. Même si, juste avant de quitter Manudécors, j’ai fait le plus gros décor de théâtre jamais construit, douze ou quatorze tonnes de ferraille et tout à l’avenant… On ne comptait plus les châssis, on comptait les semi-remorques. On avait rempli le studio H à Epinay, un studio énorme, pour un décor de Serge Marzolff : immeuble genre place des Vosges sur trois étages, cour pavée, jardin, dépendances etc.[10]
Ma compagne venait d’obtenir un poste de codirection à la Scène Nationale d’Aubusson et j’ai été embauché comme régisseur général en même temps qu’elle. J’ai passé deux ans là-bas, à la technique, deux années inoubliables où nous avons fait des prodiges avec des moyens misérables. La programmation était très ambitieuse, mais les budgets alloués à la technique n’étaient pas à la hauteur. Faute d’entente avec mon directeur, je suis parti.
J’ai ensuit été contacté par Mireille Vignaud, l’administratrice de la compagnie de Jean-Marie Villégier[11], que j’avais connue au Festival de La Rochelle et qui m’avait confié à l’époque la conception et la réalisation d’un décor pour une manifestation de Valère Novarina. J’ai tourné avec Jean-Marie en tant que régisseur général, création et tournée et je souhaite à tous les techniciens de travailler avec un metteur en scène possédant sa culture et ses qualités humaines.
Transmettre son expérience et son savoir
A partir de 1996 j’ai commencé également à donner des cours plus réguliers au CFPTS, dans le domaine de la construction de décors pour commencer (formation continue). Puis j’ai eu l’occasion de créer de nouvelles formations, avec Gérard Rocher notamment. L’exercice était nouveau pour moi : formaliser les choses et les articuler avant de donner le cours, tout repenser de A à Z, y compris ce qu’on n’avait pas bien saisi… Il n’y a pas plus excitant (et flatteur je le confesse) que de pouvoir transmettre des savoirs à la génération qui nous suit.
Moë-Kan : Tu interviens donc à un moment de l’histoire du CFPTS où il n’existe pas de formation initiale ?
BR : Si il existait déjà les FI (formation initiale), mais c’était avant le CFA. A la demande du directeur de l’époque, j’ai été chargé, avec trois autres formateurs, de définir le programme du futur CFA. Et puis le CFA a été lancé. Nous en sommes aujourd’hui à la dix-septième promotion, avec le succès que l’on sait.
[1] Nicola Sabbattini, Pratique pour fabriquer scènes et machines de théâtre, Ides et Calendes, 1994.
[2] Voir la Gazette de juin 2015 pour des extraits choisis de cette étude. Lien.
[3] http://remacle.org/bloodwolf/erudits/heron/pneumatiques.htm
[4] http://fr.wikipedia.org/wiki/Nicola_Sabbattini
[5] http://www.erudit.org/culture/jeu1060667/jeu1071821/29194ac.pdf
[6] http://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Dumézil
[7] http://fr.wikipedia.org/wiki/Communauté_taisible
[8] A cette époque, le jour férié pour les écoliers était le jeudi et non le mercredi.
[9] André Roy, Larousse, 1956
[10] http://serge-marzolff.com/sm_television.htm
[11] http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Marie_Villégier